L’éclairage de Yassir Yebba
21 Novembre 2019
Afin d’éclairer les partenaires européens sur les problématiques liées au lancement d’une activité de food trucks par des jeunes, Yassir Yebba a donné une conférence. Au mot « l’insertion », il préfère celui d’« inclusion ». Extraits pour mieux comprendre sa pensée…
« Si vous voulez être actif dans votre vie, vous devez trouver le moyen de devenir votre propre héros, en passant du simple CV à ce que j’appelle un synopsis. D’un côté, vous êtes le simple acteur d’un système ou d’une entreprise qui vous fournit un travail. De l’autre vous proposez une histoire aux gens. »
« Écrire son histoire c’est évidemment beaucoup plus facile si on a un scénario. Il faut donc réfléchir à ce qu’est votre monde ordinaire mais aussi votre monde extraordinaire. Ce que seraient vos super pouvoirs si vous en aviez. »
« Pour moi le passage de l’insertion à l’inclusion est de s’accepter en tant qu’humain, de vivre sa vie de H à H, c’est-à-dire d’humain à humain, d’histoire à histoire, d’héritage à héritage. Si je n’accepte pas ce que je suis, avec mon propre héritage, avec ma propre histoire, je ne trouverai pas vraiment ma place. »
« Le problème dans le secteur de la nourriture est faire en sorte que les gens payent, pas seulement pour le produit mais aussi pour les gens, pour les histoires qu’il y a derrière le produit. Le modèle de l’inclusion doit permettre de créer de la valeur. C’est ce que j’appelle la reconnaissance. »
Yassir Yebba
L’anthropologue cuisinier
Dans le cadre du projet européen, plusieurs opérateurs venus d’Europe ont pu échanger avec Yassir Yebba. À la fois anthropologue et cuisinier, il porte un regard particulièrement intéressant sur l’alimentation. Rencontre avec un homme de conviction et d’action.
Anthropologue et cuisinier, ce n’est pas une association banale. Comment en êtes-vous arrivé là ?
Je suis d’origine modeste. Mes parents marocains sont arrivés en France lorsque j’avais cinq ans. Ils ne savaient ni lire ni écrire, n’étaient jamais allés à l’école et pourtant je me suis rendu compte que c’étaient des gens qui savaient. Cela m’a amené à m’intéresser à la pensée qui vient des mains. Le philosophe allemand Martin Heidegger ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit « la pensée est un travail manuel ». Ce n’est ni le premier ni le dernier à l’avoir dit et beaucoup de philosophes contemporains cherchent à concilier ces deux univers généralement opposés. Je trouve par exemple très intéressante la démarche de l’américain Matthew B. Crawford qui a abandonné sa brillante carrière universitaire pour monter un atelier de réparation de motos. De cette expérience, il a tiré un livre Éloge du carburateur – Essai sur le sens et la valeur du travail. Je m’inscris dans cette lignée d’intellectuels qui disent que faire est une manière de penser. Je ne serais pas un bon anthropologue si tous les jours je ne faisais pas avec mes mains.
Vous auriez pu choisir la plomberie ou la menuiserie plutôt que la cuisine ?
La cuisine est arrivée dans ma vie il y a vingt ans. J’en avais alors trente. Je venais de me séparer de ma compagne, notre fils était encore tout petit. J’ai éprouvé le besoin de lui faire à manger. C’était pour moi une manière de prendre soin de lui et de lui transmettre quelque chose de ma culture. Je suis marocain par le ventre : je lui ai donc transmis ma culture en lui faisant à manger.
Je suis venu à la cuisine d’abord en tant que papa, c’est dans un second temps que je me suis rendu compte que je réfléchissais mieux quand je cuisinais.
Que qu’est-il passé ensuite ?
J’ai quitté l’université pour créer Territoires alimentaires, mon propre laboratoire de recherches et Le Goût du monde, une entreprise de cuisine événementielle. J’y ai par exemple développé des conférences gourmandes : des moments conviviaux qui mêlent réflexion intellectuelle sur l’alimentation et proposition gourmande. L’idée de ces rendez-vous est simple : penser aussi bien que l’on mange et manger aussi bien que l’on pense. Je ne suis pas un traiteur mais un « bien-traiteur ». Ce qui est important pour moi, c’est que faire à manger, c’est être dans le plaisir concret du soin à l’autre. J’ai beaucoup travaillé à la notion de chaine du soin.
Vous avez fait de l’anthropologie alimentaire bien avant de devenir cuisinier professionnel…
J’ai d’abord commencé par faire de l’anthropologie culturelle en m’intéressant aux Berbères dans les campagnes et montagnes marocaines. Sur le terrain, j’ai vu que ces gens-là étaient heureux parce qu’ils étaient en lien avec la nature, avec le sol. C’est à partir du sol qu’ils bâtissaient une société. Avec eux, je me suis rendu compte que la nourriture était un formidable lien à la vie.
Vous faites aussi la relation entre alimentation et langue…
Ce que mange en premier l’être humain, ce sont des mots. La nourriture, c’est la première langue. C’est quelque chose qui m’a frappé chez les Berbères : les gens qui parlaient le berbère tous les jours mangeaient bien tous les jours. À mon retour en France, j’ai cherché si les mêmes liens entre parler et manger existaient. J’ai trouvé les mêmes phénomènes dans la ruralité et dans la paysannerie en Nouvelle-Aquitaine, la région où je vis. Les endroits où l’on parle des langues régionales (poitevin-saintongeais, occitan, gascon, basque) sont aussi les endroits où l’on mange le mieux. Prenons l’exemple des Basques. Il existe chez eux un lien étroit entre nourriture et langue. Les Basques sont des gens qui donnent à manger leur culture.
Vous fustigez régulièrement la nourriture industrielle…
C’est ce que l’on mange qui fait de nous ce que nous sommes. On est ce que l’on mange. En mangeant quelque chose de mal fait, on participe à son propre déclassement social. Si on mange industriel, on finit par penser industriel. Au supermarché, on se sert comme dans un catalogue mais notre dignité d’être humain c’est de savoir réfléchir, de comprendre comment ça pousse. C’est mieux de cueillir que d’ouvrir un paquet. Il faut refaire de l’alimentation une expérience. Mes parents modestes étaient des bobos magnifiques : ils mangeaient local et en circuits courts. Je fais comme eux. Je ne mange par exemple que de la viande que j’ai abattue moi-même.
Rendre accessibles les bons produits à tous est un signe de la bonne santé d’une société. J’aime citer cette phrase de Claude Levis-Strauss « Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu’il soit bon à penser ».
Vous dites « Je suis de là où je mange, je suis d’ici car je mange ici chaque jour. Je mange des paysages français » pourriez-vous expliquer ?
Dans ma recherche, j’ai développé le concept du « repaysement » qui est l’apaisement par le paysage. Or le paysage est aussi accessible par l’assiette. Quand je vais au Maroc j’amène avec moi de bonnes choses françaises pour ne pas être dépaysé et inversement : j’utilise des épices marocaines dans la cuisine française. Je ressens un grand apaisement à reconnaître de manière organique ce que je suis, là où je suis. Ce qui nourrit nous constitue, c’est certain.
Informations pratiques
Yassir Yebba
yassiryebba.fr
© Sonia Moumen (rapporteuse des échanges) pour Champs Libres membre de Kus Alliance France
This post is also available in: AnglaisAllemandPortugais - du Portugal








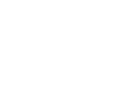

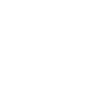

Leave a reply